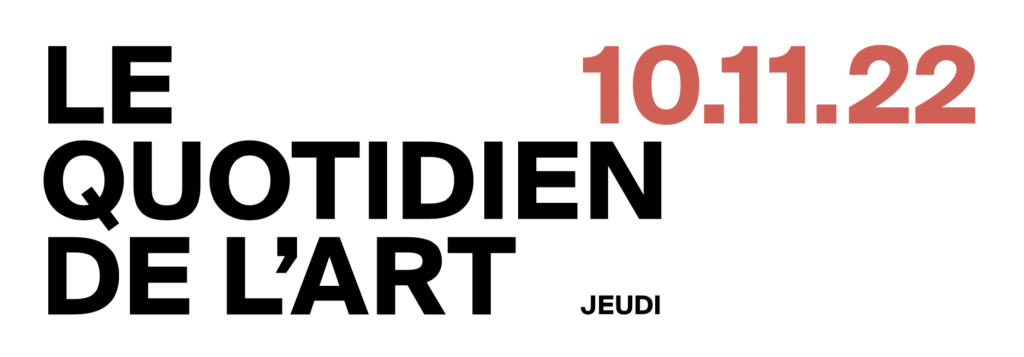Mettre en lumière / To highlight
Par Lillian Davies
En septembre dernier, afin de préparer mon article pour le Quotidien de l’Art, Aurélia Zahedi m’avait invité à passer quelques jours dans son domicile actuel, une maison située dans un petit village à environ une heure d’Agen.
En ces temps de confinements et de contraintes, mon séjour allait me rappeler
à quel point l’expérience physique d’une rencontre est importante et, dans mon cas, nécessaire à comprendre le travail de l’artiste.
Après ma première nuit à Maison Auriolles, un centre de recherche co-fondé en 2018 par l’artiste Aurélia Zahedi, j’ai trouvé un mot sur la table de la cuisine écrit sur papier rose : « Je suis allée jouer de l’orgue. De retour à 9h30. »
Comme Zahedi m’avait vanté l’énergie vitale du Lot, rivière accessible par un petit chemin depuis la propriété ancienne qui accueille le centre, j’avais décidé d’y plonger. Plus tard dans son atelier, avec une tasse de verveine de son jardin dans les mains, Zahedi m’a expliqué que pratiquer l’orgue dans les églises environnantes, dont elle détient les clefs, c’est ça son petit déjeuner. Elle est attirée par cet instrument auquel on ne peut jouer qu’après une ascension à l’intérieur des nefs de pierre et par sa musique « qui accompagne les morts. » Parcourant les claviers avec ses mains et ses pieds, elle voit s’ouvrir les portes de son cerveau.
Zahedi a grandi dans le centre de la France. Elle a étudié les arts visuels à Avignon puis ensuite à la Villa Arson, où elle a présenté comme projet final une nature morte en tant qu’installation, Sans titre (2012). Sur la pelouse immaculée de l’institution gisait une chèvre morte attachée à des ballons gonflés d’hélium, d’une palette de roses, oranges et verts brillants. Même si Zahedi ne se positionne pas comme peintre, son approche artistique se fait dans un cadre pictural avec le plus souvent pour objet la toile et ses enjeux de lumière.
Pour manipuler, même « brûler la lumière », Zahedi a commencé a utiliser des paillettes dès 2013 lors de son installation Sans titre, dans le cadre de l’exposition inaugurale de la Galerie Eva Vautier à Nice. Des poissons, à priori des bars, changés chaque jour et posés sur une mer de paillettes argentées étalées à même le sol. « J’utilise les paillettes pour maquiller quelque chose de difficile à regarder », explique-t-elle pour justifier son appropriation de ce matériau aussi enfantin que jubilatoire pour « Paysages Désenchantés » (2015). Zahedi l’applique comme de la peinture sur les toiles de cette série. Dans chaque œuvre, elle représente un animal mort avec un beauté tragique qui rappelle le registre dramatique des productions d’Angélica Liddell. Presque cachée et embellit par une composition complexe et éblouissante, la forme de l’animal se fond dans un festin de couleurs et de reflets.
Fin 2021, dans une salle du Musée des Beaux-Arts de Nancy, au milieu d’œuvres de Caravage et Rubens, Zahedi présentait Tapis de fleurs (2013), une accumulation de fleurs en soie ou en plastique, aux couleurs passées, trouvées dans des poubelles de cimetières. L’œuvre s’adapte aux dimensions du lieu d’exposition. De plus en plus soucieuse du contexte, Zahedi dit vouloir s’exposer dans les lieux de culte « où le sacré est déjà présent. » « La relique est la première forme d’exposition » affirme-t-elle. À Nancy, comme à Avignon, dans l’Église des Célestins, son œuvre « est entourée d’icônes, la Vierge n’est pas loin. » Dans son travail avec les charognes, trouvées dans la forêt ou données par des amis ou des villageois, Zahedi définit son geste artistique en les « mettant en lumière », à la manière de Jean-Henri Fabre. Elle se réfère parfois au naturaliste, philosophe et poète du 19e siècle, connu pour son travail méticuleux associé à une grande liberté d’interprétation, comme par exemple sur certains anthropoïdes comme le scarabée sacré. Inspirée par son attention, sa discipline du regard et sa capacité d’observer et de dépeindre, Zahedi dit « c’est ça être artiste : raconter une histoire ». Dans ses œuvres comme Madame le Sanglier (2015) où un crâne de l’animal est posé sur une colonne habillée en tissu rouge scintillant ou alors dans Danse macabre (2014) où une branche d’arbre morte est ornée avec des carcasses de pigeons, nous voyons l’artiste créer des personnages pour ses contes fantastiques.
C’est la rose de Jéricho qui s’épanouit au cœur du travail de Zahedi, une plante d’une « beauté modeste », nomade et quasi-immortelle, entourée de légendes. Certains disent qu’elle ne fleurit que là où les pieds de la Vierge ont touché la terre. Mais la Vierge n’est à priori jamais passée par Jéricho. Avec le soutien du Fanak Fund, Zahedi prépare actuellement un voyage en Palestine où elle travaillera avec des Bédouins pour imaginer la route que la Vierge Marie aurait pu emprunter si elle était passée par cette ville, qui fit partie de l’Empire Romain puis du califat d’Umayyad et de l’Empire Ottoman, et qui est aujourd’hui divisée par les conflits de la Cisjordanie. En préparation à ce travail in situ, Zahedi recherche des images des pieds de la Vierge Marie pendant sa fuite en Égypte. Elle souhaite graver son empreinte imaginaire sur des pierres dans le désert puis créer une cartographie de son chemin en français et en arabe. Dans Repos de la Sainte Famille d’Orazio Gentileschi (1625-1650), le pied nu de la Vierge Marie est visible et surprenant par sa grande taille. Dans cette composition, alors que Joseph, épuisé, s’allonge sur leurs modestes bagages, elle a la force d’allaiter l’enfant sacré.
Ce moment de repos est important, car c’est un état dit « de dormance », que la rose traverse elle aussi, ne s’ouvrant qu’au contact de l’eau. Zahedi ressuscite la plante lors de ses contes conférences ou l’utilise, trempée d’encre, pour que de son ouverture naisse un dessin, Réveils (2020). Cet « état de dormance » Zahedi le cherche aussi à Maison Auriolles, une « maison sans objectif ». Après un parcours institutionnel de qualité, passant par la Villa Arson, le Salon de Montrouge, ou encore le Quai Branly, Zahedi a décidé de se mettre en retrait, de chercher une voie alternative. « Maison Auriolles est un acte politique », explique l’artiste. Là-bas, Zahedi vit avec une cheffe de chœur, une comédienne, un fermier, un médecin et un jeune homme qui dresse des ânes pour ensuite les faire travailler dans des fermes biologiques. Les portes de la maison sont toujours ouvertes. Autour de la table les visiteurs sont fréquents, que ce soit pour partager leurs idées ou leur pain. Dès qu’il y a un rayon de soleil, la table est sortie le long d’un étang recouvert de lotus provenant des mêmes bulbes que ceux de Giverny. L’histoire veut que Monet les ait récoltés dans un château voisin. Zahedi envisage de créer un cimetière au sein du domaine, comme un écrin en plein air pour sa collection de charognes qui ne cesse de grandir.
Ce sera un cimetière qui rend la mort visible, un prétexte pour la musique, la littérature ou alors le théâtre.
La voix de Zahedi peut être régulièrement entendue à la radio locale dans son émission, « La Nef des Fous. » Ce titre est emprunté au conte de Sébastien Brant (1494) et illustré dans la toile éponyme de Jérôme Bosch (1490-1500), l’histoire d’une bande hétéroclite d’hérétiques jubilatoires au large sans capitaine. C’est une scène qui rappelle celle qu’elle compose à Maison Auriolles, une maison
« toujours humide. Ici on flotte sur l’eau ». En naviguant vers la mort, le travail de Zahedi célèbre la vie.
A propos dʼAurélia ZAHEDI,
texte de Stéphane Corréard, critique d’art, directeur du salon Galeristes, ancien directeur du Salon de Montrouge à Paris.
« On entre dans une installation dʼAurélia Zahedi comme dans LʼEscarpolette de Fragonard, et on en ressort comme des caprices de Goya… « Je tiens à une première approche de séduction, provoquée par le merveilleux dans lʼimage, qui laisse place à une plus sombre amertume » reconnaît-elle. De loin tout nʼest que fleurs, danse, paillettes, mais de près ce sont des cadavres dʼanimaux et les souvenirs funéraires qui sautent à la gorge. Aurélia Zahedi revendique crânement la pratique artistique comme fabrique dʼillusions, de pièges à sentiments, mais à lʼapproche ses compositions cèdent la place à des décompositions, avatars contemporains des natures mortes ou des vanités dans La société du spectacle.
Tout ce qui, dans la peinture ancienne, chatoyait ou étincelait les compositions florales, le vernis, les flancs argentés de poissons à écailles, est étalé là, bien réel, sous nos yeux, sous notre nez aussi, putride, graisseux… Son Tapis de fleurs (2012) mêle vraies et fausses fleurs, mais toutes ont été ramassées au cimetière, et empestent soit la vieille poussière, soit le pourri. Idem pour sa gracile Danse macabre (2013) : foin dʼinsouciants volatiles sur la branche, car lʼarbre et les pigeons sont pareillement morts, et même momifiés. Le monde que nous promet Aurélia Zahedi est le nôtre, un monde en putréfaction qui se maquille outrageusement comme une courtisane fanée, mais ne parvient pas à dissimuler les os qui percent sous sa joue car elle nʼest plus quʼun squelette.
One enters Aurélia Zahediʼs installation as if one were entering Fragonardʼs
« LʼEscarpolette », and one exits them as if exiting Goyaʼs « Caprices »… « I like to have a seductive first approach, which comes from the marvelous aspect of the image, before giving way to a darker bitterness », she admits. Seen from afar there are flowers, dance, glitter, but seen up close corpses of animals and funerary memories jump out at us. Aurélia Zahedi gallantly claims that artistic practice is a factory of illusions, of emotional traps, but upon closer inspection her composition become decompositions, contemporary avatars of the still lives and vanitas in « The Society of the Spectacle ».
Everything that was shiny or bright in classical painting, floral compositions, glazes, the silver scales of fish, is spread out here, completely real, before our eyes, before our nose as well, putrid, greasy… Her « Carpet of Flowers » (2012) mixes real and fake flowers, all of which have been picked in a cemetery, and reek either ofdust or of rot. The same is true of her sylphic « Danse Macabre » (2013) : instead of carefree birds on a branch, both the tree and the pigeons are dead, and even mummified. The world promised us by Aurélia Zahedi is our very own, a rotting world utrageously made up like a withered courtisan, who fails in hiding the bones jutting out from her cheeks, for she has become a mere skeleton. »
A propos d’Aurélia ZAHEDI,
texte de Vincent Labaume, artiste polygraphe.
Pas de deux
Douceur dramatique. La formule est d’Aurélia Zahedi et elle colle avec son boulot. Rien d’emblée qui choque ou blesse le regard, plutôt des choses qui séduisent et attirent : des autels chatoyants ornés de perles, un tapis de fleurs, une mare de paillettes, un bouquet dans un vase, des ballons de couleur qui volent en grappe, une branche d’arbre coupée qui s’égaye d’oiseaux… Bienvenue dans le monde jamais périmé du merveilleux de l’enfance. Ce n’est qu’à l’approchement desdits que survient le drame : un rat crevé pend au cœur de l’autel ; le bouquet est suintant de graisse d’huile de moteur ; les fleurs du tapis sentent le pourri du cimetière où l’artiste les a glanées ; un chevreau mort retient les ballons ; ce sont d’atroces squelettes de pigeons qui font les cons. Avant que l’écœurement vous saisisse, vous réalisez que le but de l’artiste pourrait avoir été de contraindre les contraires à vous amener au choc du dernier sursaut esthétique : devant la mort, je sens ma vie. S’agit-il d’une simple recharge littérale des vieilles vanités peintes d’autrefois, ou bien une moderne perversion baudelairienne à considérer le souffle froid de la charogne comme le fin du fin du très fin frisson de l’art ? Pour autant, pas plus que pour vous ou moi, la charogne n’est du goût d’Aurélia Zahedi. C’est l’état de mort, et lui seul, qui l’intéresse, et non celui de putréfaction ou de sépulture (pour reprendre une distinction de Renan) : l’état de mort s’adressant au sujet vivant qui lui fait face, tandis que la charogne sous sépulture ne s’adresse plus à personne en particulier. Les œuvres et installations d’Aurélia Zahedi sont dévolues à cet état par lequel elle prétend « désacraliser la mort » et la faire accéder au rang de beauté merveilleuse. Ce n’est pas tant le regardeur qu’elle cherche à piéger que la mort elle-même, cette Camarde qui rôde dans l’art, comme dans la vie, depuis son commencement. Mon Portrait squelettisé est une gravure à l’eau-forte de James Ensor, réalisée en 1889 à partir d’une photographie de lui, posant appuyé contre un miroir. L’eau-forte a creusé les chairs de l’image jusqu’à l’os mais le visage et le corps cadavérisés de l’artiste tiennent la même pose. L’instant de la mort semble être passé sur lui comme l’instant de l’image qui l’avait capturé, brouillant le face-à-face avec le rictus macabre de l’éternité. Parmi les dernières œuvres d’Aurélia Zahedi, sans cadavre d’animal cette fois, on remarque un moulage posé en l’air du pied nu en pointe de l’artiste, affleurant la surface d’eau noire d’une vasque elliptique (Héléade, 2014). Une installation sonore antérieure montrait des paires de chaussures fixées dans le mouvement d’une valse sur un parquet rivé à des palettes de chantier (Les Valseurs, 2013). Les pièges de mort sont ici dépouillés de leur dialectique, reste un pas à faire, un pas de deux avec l’œuvre, comme un homme libre. « L’homme libre trouve toujours une piste de danse. » Kierkegaard.
Dramatic sweetness. The formula is Aurélia Zahedi’s own, and it fits with her work. Nothing instantly offensive or shocking, but rather things that seduce and attract: shimmering altars decorated with pearls, a carpet of flowers, a pool of glitter, a bouquet in a vase, colourful balloons flying in clusters, a cut tree branch embellished by birds… Welcome to the never-expired world of childhood wonder! But at a closer look, these artworks yield their tragedy: a dead rat hangs in the heart of the altar; the bouquet oozes engine oil grease; the flowers give off the rot of the cemetery where the artist plucked them; a dead baby goat holds the balloons; horrifying skeletons of pigeons mess about on the branch. Before repulsion seizes you, you realize that the artist’s purpose may be to force opposites to make you experience the impact of a last aesthetic spasm: before death, I feel my life. Is it simply a literal refill of the traditional painted vanities of old, or a modern Baudelairian perversion that considers the carcass’ cold breath as the cream of the crop of the very refined thrill of art? Having said that, Aurélia Zahedi dislikes carrion as much as you or me. It is the state of death, and it alone, that interests her, and not that of putrefaction or burial (to quote a distinction by Renan): the state of death that addresses the living subject facing it, while a buried carrion no longer addresses anyone in particular. Aurélia Zahedi’s works and installations are devoted to this state and are meant to “desacralize death” and make it enter the rank of marvellous beauty. It is not so much the viewer that she seeks to trap, but death itself, the Grim Reaper that lurks in art, as in life, from the very beginning.
Mon Portrait squelettisé (skeletonized self-portrait) is an 1889 etching by James Ensor based on a photograph of the artist posing leaning against a mirror. The etching has eaten the flesh of the image to the bone, but the face and the corpse-like body of the artist keep the pose. The moment of death seems to have passed over him just like the moment of the image that captured him, blurring the face-off with the macabre rictus of eternity. Among Aurélia Zahedi’s latest works – this time free of dead animals – we see a mould of the artist’s bare foot standing on tiptoe emerging from the black water surface of an elliptical basin (Héléade, 2014). An earlier sound installation featured pairs of shoes frozen in a waltz step on a floor riveted to wooden pallets (Les Valseurs, 2013). The snares of death are here stripped of their dialectic: there is a step left to take, a pas de deux with the work like a free man. Paraphrasing Kierkegaard, “the free man always finds a dance floor”.
CATALOGUES
Le Quotidien de l’Art, novembre 2022.
« Action(s) locale(s), Les nouveaux territoires politiques », Les cahiers de la Maison Forte, Automne 2022.
La céramique comme expérience: Volume 3, Sicile & Co, Ed Naima, 2018.
Catalogue du 60 ème Salon de Montrouge, Paris.
Catalogue Parcours de lʼArt Avignon, XX ème édition, 1995-2014, Avignon.
Catalogue de la promotion 2013 de lʼEcole Nationale Supérieure dʼArt, Villa Arson, Nice.